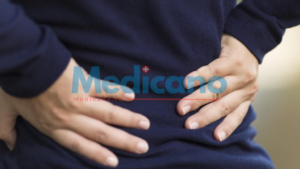La neurologie, cette branche fascinante de la médecine qui s’intéresse au système nerveux central et périphérique, connaît depuis quelques années une évolution spectaculaire. Des maladies autrefois considérées comme incurables voient apparaître de nouvelles options thérapeutiques prometteuses, tandis que notre compréhension du cerveau humain s’affine grâce à des technologies d’imagerie de plus en plus sophistiquées. Cet article se propose d’explorer les avancées les plus significatives dans le domaine de la neurologie, tant sur le plan des traitements que des innovations technologiques qui révolutionnent la prise en charge des patients.
Qu’il s’agisse de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, d’accidents vasculaires cérébraux, de troubles neuromusculaires ou encore de l’épilepsie, les chercheurs et cliniciens repoussent chaque jour les limites de ce qui est possible. Ces progrès n’améliorent pas seulement l’espérance de vie des patients, mais aussi leur qualité de vie, un aspect fondamental souvent négligé dans le traitement des maladies neurologiques chroniques.
Plongeons ensemble dans ce panorama des innovations neurologiques qui façonnent la médecine de demain.
Les avancées dans le traitement des maladies neurodégénératives
Maladie d’Alzheimer : de nouveaux espoirs thérapeutiques
La maladie d’Alzheimer, qui affecte plus de 50 millions de personnes dans le monde, est restée pendant longtemps sans traitement modificateur de la maladie. Cependant, ces dernières années ont vu l’émergence de thérapies ciblant les mécanismes pathologiques fondamentaux.
L’une des avancées les plus significatives concerne les anticorps monoclonaux ciblant les plaques amyloïdes, considérées comme l’une des causes principales de la dégénérescence neuronale. Les médicaments comme le lecanemab (Leqembi) et l’aducanumab (Aduhelm) ont montré une capacité à réduire significativement les plaques amyloïdes dans le cerveau. Le lecanemab, en particulier, a démontré un ralentissement de 27% du déclin cognitif chez les patients aux stades précoces de la maladie, marquant un tournant dans la prise en charge de l’Alzheimer.
Par ailleurs, les recherches sur les inhibiteurs de la protéine Tau, autre cible thérapeutique majeure, progressent également. Des molécules comme le LMTX (hydromethylthionine) ont montré des résultats encourageants dans des essais cliniques de phase 3, avec une amélioration des fonctions cognitives et une réduction de l’atrophie cérébrale.
Un autre axe prometteur concerne l’immunothérapie active, qui vise à stimuler le système immunitaire du patient pour éliminer les protéines pathologiques. Le vaccin AADvac1, ciblant la protéine Tau, a montré des résultats préliminaires encourageants en termes de sécurité et d’efficacité.
Maladie de Parkinson : vers une médecine personnalisée
La maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer, bénéficie également d’avancées thérapeutiques majeures. L’approche de la médecine personnalisée gagne du terrain, tenant compte des variations génétiques et des sous-types cliniques de la maladie.
Les thérapies de remplacement dopaminergique ont connu des améliorations significatives avec l’introduction de nouvelles formulations à libération contrôlée et de voies d’administration innovantes. Le système de perfusion sous-cutanée continue d’apomorphine et la formulation inhalée de lévodopa (Inbrija) offrent une gestion plus précise des fluctuations motrices.
La stimulation cérébrale profonde (SCP), technique neurochirurgicale bien établie, s’affine également. Les systèmes de stimulation adaptative, capables d’ajuster les paramètres de stimulation en fonction de l’activité cérébrale du patient en temps réel, représentent une avancée majeure. Ces dispositifs « en boucle fermée » permettent de réduire les effets secondaires tout en optimisant le contrôle des symptômes.
Les thérapies géniques suscitent un intérêt croissant. L’essai clinique utilisant le vecteur viral AAV2-GDNF pour délivrer le facteur neurotrophique dérivé de la glie (GDNF) directement dans le putamen des patients a montré des résultats prometteurs en termes de neuroprotection et d’amélioration des symptômes moteurs.
Sclérose en plaques : une révolution thérapeutique
La sclérose en plaques (SEP) illustre parfaitement la révolution thérapeutique en neurologie. D’une maladie aux options de traitement limitées il y a 30 ans, la SEP dispose aujourd’hui d’un arsenal thérapeutique de plus de 20 médicaments modificateurs de la maladie.
Les anticorps monoclonaux comme l’ocrelizumab (Ocrevus) et l’ofatumumab (Kesimpta) ciblent les lymphocytes B, acteurs clés dans la pathogénie de la SEP. Ces traitements ont démontré une efficacité remarquable dans la réduction des poussées et du risque de progression du handicap, y compris dans les formes progressives de la maladie, longtemps considérées comme résistantes aux traitements.
La thérapie par cellules souches hématopoïétiques (HSCT) représente une option thérapeutique prometteuse pour les formes sévères et actives de SEP. Cette approche, qui consiste à « réinitialiser » le système immunitaire du patient, a montré des taux de rémission à long terme impressionnants dans plusieurs études cliniques.
Les modulateurs des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) comme le ponesimod et l’ozanimod constituent également une avancée significative, offrant une efficacité accrue et un meilleur profil de sécurité par rapport aux traitements de première génération.
Les innovations dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux
La thrombectomie mécanique : extension des fenêtres thérapeutiques
L’accident vasculaire cérébral (AVC) reste une cause majeure de mortalité et de handicap dans le monde. Cependant, la prise en charge de l’AVC ischémique a connu une véritable révolution avec l’avènement de la thrombectomie mécanique.
Les études DAWN et DEFUSE 3 ont démontré l’efficacité de cette technique jusqu’à 24 heures après le début des symptômes chez des patients sélectionnés sur la base de l’imagerie de perfusion, élargissant considérablement la fenêtre thérapeutique traditionnelle de 4,5 heures pour la thrombolyse intraveineuse.
Les dispositifs de thrombectomie de nouvelle génération, comme les stents récupérateurs et les systèmes d’aspiration à large lumière, ont significativement amélioré les taux de recanalisation et les résultats cliniques. Des techniques combinées, associant thrombolyse et thrombectomie, sont également à l’étude pour optimiser la prise en charge des patients victimes d’AVC.
Neuroprotection et réhabilitation post-AVC
Au-delà des techniques de reperfusion, la recherche s’intensifie sur les stratégies de neuroprotection visant à limiter les dommages cérébraux secondaires. Le refroidissement cérébral ciblé, les agents neuroprotecteurs comme la NA-1 (nerinetide) et les thérapies basées sur les exosomes montrent des résultats prometteurs dans les modèles précliniques et les premiers essais cliniques.
La réhabilitation post-AVC bénéficie également d’innovations technologiques majeures. Les systèmes de réalité virtuelle immersive et les interfaces cerveau-machine permettent une rééducation plus intensive et personnalisée. L’étude VECTORS a démontré que l’utilisation précoce de ces technologies améliore significativement la récupération motrice des patients.
La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) et la stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) émergent comme des thérapies adjuvantes prometteuses pour stimuler la plasticité cérébrale et améliorer la récupération fonctionnelle après un AVC.
Épilepsie : vers une approche personnalisée et minimalement invasive
Neuromodulation et thérapie génique
L’épilepsie, qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde, voit également son arsenal thérapeutique s’enrichir considérablement. Au-delà des antiépileptiques conventionnels, de nouvelles approches de neuromodulation gagnent en importance.
La stimulation du nerf vague (VNS), technique bien établie, s’est perfectionnée avec les systèmes de stimulation adaptative qui détectent automatiquement les modifications de la fréquence cardiaque associées aux crises et ajustent la stimulation en conséquence. La stimulation cérébrale profonde du noyau antérieur du thalamus a également démontré son efficacité dans la réduction de la fréquence des crises chez les patients souffrant d’épilepsie pharmaco-résistante.
La thermocoagulation par radiofréquence stéréotaxique guidée par SEEG (Stéréo-Électroencéphalographie) permet une approche minimalement invasive pour traiter les foyers épileptogènes profonds, avec des résultats comparables à la chirurgie conventionnelle mais une morbidité significativement réduite.
La thérapie génique représente une frontière prometteuse dans le traitement de l’épilepsie. Des essais précliniques utilisant des vecteurs viraux pour délivrer des gènes codant pour des canaux ioniques inhibiteurs ou des neuropeptides anticonvulsivants ont montré une suppression durable des crises dans des modèles animaux d’épilepsie réfractaire.
Biomarqueurs et médecine de précision
L’identification de biomarqueurs spécifiques permet une approche plus personnalisée du traitement de l’épilepsie. Les analyses génétiques à haut débit ont identifié de nombreuses mutations associées à différents syndromes épileptiques, permettant une sélection plus rationnelle des médicaments.
Par exemple, les patients présentant une mutation du gène SCN1A (syndrome de Dravet) répondent mieux au stiripentol et aux cannabinoïdes qu’aux bloqueurs des canaux sodiques, qui peuvent aggraver les crises. Le cannabidiol (Epidiolex), approuvé pour le traitement du syndrome de Dravet et du syndrome de Lennox-Gastaut, représente la première thérapie ciblée dérivée de cette approche de médecine de précision.
Les techniques d’imagerie avancées comme la TEP-IRM hybride et l’IRM à ultra-haut champ (7 Tesla) améliorent considérablement la détection des malformations du développement cortical, causes fréquentes d’épilepsie pharmacorésistante, permettant une planification chirurgicale plus précise.
Les technologies émergentes en neurologie
Intelligence artificielle et big data
L’intelligence artificielle (IA) transforme profondément la pratique neurologique, de l’interprétation des examens d’imagerie au diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. Les algorithmes d’apprentissage profond sont capables de détecter des anomalies subtiles sur les IRM cérébrales, parfois invisibles à l’œil humain, permettant un diagnostic plus précoce et précis.
Dans la maladie d’Alzheimer, les modèles d’IA analysant les IRM structurelles, la TEP-amyloïde et les données cliniques peuvent prédire avec une précision de plus de 90% la conversion du trouble cognitif léger vers la démence plusieurs années avant l’apparition des symptômes cliniques. Ces outils ouvrent la voie à des interventions thérapeutiques plus précoces, à un stade où elles seraient potentiellement plus efficaces.
L’analyse automatisée des signaux EEG par IA révolutionne également la détection et la prédiction des crises d’épilepsie. Des systèmes d’alerte précoce, capables de détecter les signes précurseurs d’une crise plusieurs minutes avant son déclenchement, sont en développement, offrant aux patients la possibilité de se mettre en sécurité ou de prendre des médicaments préventifs.
Interfaces cerveau-machine et neuroprothèses
Les interfaces cerveau-machine (ICM) représentent une frontière passionnante de la neurologie moderne. Ces dispositifs, qui traduisent l’activité cérébrale en commandes pour des appareils externes, offrent de nouvelles perspectives pour les patients souffrant de paralysie ou de troubles moteurs sévères.
Les ICM invasives, utilisant des électrodes implantées directement dans le cortex moteur, ont permis à des patients tétraplégiques de contrôler des bras robotiques avec suffisamment de précision pour réaliser des tâches quotidiennes comme boire ou se nourrir. Le système BrainGate, pionnier dans ce domaine, continue d’améliorer la précision et la fluidité des mouvements générés.
Les ICM non invasives, basées sur l’électroencéphalographie (EEG) ou la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS), bien que moins précises, deviennent de plus en plus accessibles. Des applications cliniques comme la communication assistée pour les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou la rééducation post-AVC sont déjà une réalité.
Les neuroprothèses sensorielles, comme les implants cochléaires et rétiniens, bénéficient également d’avancées technologiques majeures. Les implants rétiniens de nouvelle génération offrent une résolution spatiale accrue, permettant aux patients atteints de rétinite pigmentaire de reconnaître des formes et même de lire des caractères de grande taille.
Thérapies basées sur les ultrasons focalisés
La technologie des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) émerge comme une option thérapeutique non invasive prometteuse en neurologie. Dans la maladie de Parkinson, la thalamotomie par HIFU a démontré une efficacité comparable à la stimulation cérébrale profonde pour le traitement du tremblement essentiel et des tremblements parkinsoniens, sans nécessiter d’implantation chirurgicale.
Au-delà de leurs effets ablatifs, les ultrasons focalisés de faible intensité peuvent également être utilisés pour ouvrir temporairement la barrière hémato-encéphalique de manière ciblée. Cette technique révolutionnaire permet d’améliorer la délivrance de médicaments, d’anticorps thérapeutiques ou de vecteurs de thérapie génique dans des régions spécifiques du cerveau, contournant ainsi l’obstacle majeur que représente la barrière hémato-encéphalique pour le traitement des maladies neurologiques.
Des essais cliniques utilisant cette approche pour délivrer des anticorps anti-amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer ont montré une réduction significative des plaques amyloïdes avec un nombre réduit de séances de traitement par rapport à l’administration systémique. Cette technique pourrait révolutionner l’administration de médicaments pour de nombreuses maladies neurologiques, permettant des doses plus faibles et des effets secondaires réduits.
Les avancées en neuro-immunologie
Sclérose latérale amyotrophique et maladies du motoneurone
La sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative fatale affectant les motoneurones, connaît également des avancées thérapeutiques significatives. L’édaravone (Radicava), un piégeur de radicaux libres, a montré un ralentissement de la progression de la maladie chez certains patients, devenant le premier traitement approuvé pour la SLA en plus de 20 ans après le riluzole.
Les thérapies antisens ciblant les mutations génétiques spécifiques, comme l’oligonucléotide antisens tofersen pour les patients présentant une mutation du gène SOD1, représentent une approche personnalisée prometteuse. Les premiers résultats des essais cliniques montrent une réduction significative des niveaux de protéine SOD1 mutante et un ralentissement potentiel de la progression de la maladie.
La recherche sur les cellules souches offre également de nouvelles perspectives. Des essais cliniques utilisant des cellules souches mésenchymateuses autologues ou des cellules souches neurales ont montré des résultats préliminaires encourageants en termes de sécurité et d’efficacité potentielle.
Maladies neuro-inflammatoires rares
Les maladies neuro-inflammatoires rares, comme les encéphalites auto-immunes et les démyélinisations inflammatoires, bénéficient d’une meilleure compréhension et de traitements plus ciblés. L’identification d’anticorps spécifiques, comme les anticorps anti-NMDA, anti-LGI1 ou anti-MOG, a transformé la prise en charge de ces maladies autrefois mal comprises.
Les thérapies ciblées, comme le rituximab pour les encéphalites anti-NMDA et le tocilizumab pour les maladies du spectre de la neuromyélite optique, ont considérablement amélioré le pronostic de ces affections potentiellement dévastatrices. Des biomarqueurs sériques et du liquide céphalo-rachidien permettent désormais un diagnostic plus précoce et un suivi plus précis de la réponse au traitement.
Approches innovantes en neuro-réhabilitation
Stimulation non invasive du cerveau
La stimulation transcrânienne à courant direct (tDCS) et la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) sont des techniques non invasives qui modulent l’excitabilité corticale, favorisant la neuroplasticité. Ces approches sont de plus en plus utilisées comme thérapies adjuvantes dans la réhabilitation post-AVC, la maladie de Parkinson, la dépression résistante et même les troubles cognitifs légers.
La rTMS à haute fréquence du cortex moteur primaire a montré une amélioration significative de la fonction motrice après un AVC, tandis que la stimulation de l’aire de Broca améliore la récupération du langage chez les patients aphasiques. Les protocoles de stimulation thêta-burst intermittente offrent des effets plus durables avec des séances de traitement plus courtes.
La tDCS, plus accessible et moins coûteuse que la rTMS, montre également des résultats prometteurs dans l’amélioration des fonctions cognitives et motrices. Des dispositifs portables de tDCS, permettant une utilisation à domicile sous supervision médicale à distance, sont en développement, démocratisant l’accès à ces thérapies neuromodulatrices.
Exosquelettes et robotique assistive
Les exosquelettes robotisés représentent une avancée majeure pour les patients souffrant de déficits moteurs. Ces dispositifs, qui fournissent une assistance mécanique aux mouvements volontaires résiduels ou remplacent entièrement la fonction motrice perdue, transforment la rééducation et améliorent l’autonomie des patients.
Les exosquelettes de marche comme Ekso GT et ReWalk permettent aux patients paraplégiques de se tenir debout et de marcher, avec des bénéfices secondaires significatifs sur la santé cardiovasculaire, la densité osseuse et la fonction intestinale et vésicale. Pour les membres supérieurs, des dispositifs comme Armeo Power facilitent la récupération motrice après un AVC en permettant une rééducation intensive et progressive.
La robotique assistive s’étend également aux troubles du langage. Des robots sociaux comme QTrobot sont utilisés dans la thérapie des troubles du spectre autistique, fournissant des interactions sociales prévisibles et non menaçantes qui aident les enfants à développer leurs compétences de communication.
Thérapies basées sur la réalité virtuelle et augmentée
La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) offrent des environnements d’entraînement immersifs et motivants pour la neuro-réhabilitation. Ces technologies permettent de créer des exercices thérapeutiques personnalisés, adaptatifs et ludiques, améliorant l’adhésion des patients aux programmes de rééducation.
Dans la rééducation post-AVC, les systèmes de RV comme CAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) combinent tapis roulant instrumenté, capture de mouvement et environnement virtuel immersif pour une rééducation à la marche multimodale. Des études contrôlées randomisées ont démontré que l’ajout de la RV aux protocoles de rééducation conventionnels améliore significativement la récupération motrice et l’équilibre.
Pour les troubles cognitifs, des applications de RA comme Constant Therapy proposent des exercices de stimulation cognitive dans des environnements quotidiens réels, améliorant le transfert des compétences acquises aux activités de la vie quotidienne. Ces approches montrent des résultats particulièrement prometteurs dans la réhabilitation cognitive après un traumatisme crânien ou un AVC.
Neurologie et médecine régénérative
Thérapies cellulaires et facteurs de croissance
La médecine régénérative offre l’espoir de réparer les tissus nerveux endommagés, longtemps considérés comme irréparables. Les cellules souches pluripotentes induites (iPSC), dérivées de cellules somatiques du patient lui-même, évitent les problèmes éthiques et immunologiques associés aux cellules souches embryonnaires, tout en conservant leur potentiel thérapeutique.
Dans la maladie de Parkinson, des essais cliniques utilisant des neurones dopaminergiques dérivés d’iPSC sont en cours, avec des résultats précliniques montrant une survie à long terme des greffons et une amélioration fonctionnelle. Pour la sclérose en plaques, des cellules précurseurs d’oligodendrocytes dérivées d’iPSC ont démontré une capacité à remyéliniser les axones dans des modèles animaux.
Les facteurs neurotrophiques, comme le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) et le NGF (Nerve Growth Factor), jouent un rôle crucial dans la survie et la différenciation neuronales. Des systèmes de délivrance innovants, comme les microsphères biodégradables et les hydrogels injectables, permettent une libération prolongée de ces facteurs, maximisant leur effet thérapeutique tout en minimisant les effets secondaires systémiques.
Bioingénierie et médecine reconstructive
La bioingénierie tissulaire permet de créer des structures tridimensionnelles qui favorisent la régénération nerveuse. Des conduits nerveux biodégradables, enrichis en facteurs de croissance et cellules de Schwann, améliorent significativement la régénération des nerfs périphériques après une lésion traumatique, offrant une alternative aux greffes autologues traditionnelles.
Pour les lésions de la moelle épinière, des échafaudages biomimétiques composés d’hydrogels et de nanofibres alignées créent un environnement favorable à la repousse axonale. Des études précliniques combinant ces échafaudages avec des cellules souches neurales et des inhibiteurs des molécules inhibitrices de croissance ont montré une récupération fonctionnelle partielle dans des modèles de section médullaire complète.
Défis éthiques et perspectives futures
Questions éthiques soulevées par les neurotechnologies
L’avancement rapide des neurotechnologies soulève d’importantes questions éthiques. Les interfaces cerveau-machine capables de lire et potentiellement d’influencer l’activité cérébrale posent des questions fondamentales sur la vie privée cognitive, l’autonomie et l’identité personnelle. Le concept de « neurodroits » émerge comme un cadre éthique et juridique visant à protéger ces dimensions essentielles de l’expérience humaine.
L’accès équitable aux innovations neurologiques constitue également un défi majeur. De nombreux traitements innovants, comme les thérapies géniques et les dispositifs de neuromodulation avancés, restent extrêmement coûteux et inaccessibles pour une grande partie de la population mondiale. Des stratégies pour réduire ces inégalités, comme des modèles de financement innovants et des partenariats public-privé, sont activement explorées.
La question du consentement éclairé se pose avec une acuité particulière pour les patients souffrant de troubles cognitifs. Des directives anticipées spécifiques aux neurotechnologies et des cadres de prise de décision partagée sont en développement pour répondre à ces défis.
Vers une médecine neurologique intégrative
L’avenir de la neurologie clinique semble s’orienter vers une approche intégrative, combinant médecine conventionnelle, technologie de pointe et approches holistiques. L’importance des facteurs de style de vie dans la santé cérébrale est de plus en plus reconnue, avec des preuves solides du rôle de l’exercice physique, de la nutrition, du sommeil et de la stimulation cognitive dans la prévention et la prise en charge des maladies neurologiques.
Le concept de « réserve cognitive », cette capacité du cerveau à compenser les dommages pathologiques grâce à des mécanismes de plasticité et d’adaptation, inspire des interventions multimodales visant à renforcer cette réserve. Des programmes combinant exercice aérobique, entraînement cognitif, nutrition méditerranéenne et interaction sociale ont montré des résultats prometteurs dans le ralentissement du déclin cognitif lié à l’âge et même dans la maladie d’Alzheimer au stade précoce.
Conclusion
La neurologie traverse une période d’innovation sans précédent, transformant profondément la prise en charge de maladies autrefois considérées comme intraitables. Des avancées dans la compréhension des mécanismes pathologiques fondamentaux aux technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et les interfaces cerveau-machine, chaque aspect de la pratique neurologique est en pleine évolution.
Ces progrès offrent un espoir renouvelé aux millions de patients souffrant de maladies neurologiques dans le monde. Cependant, ils soulèvent également d’importants défis en termes d’accessibilité, d’équité et d’éthique qui devront être adressés pour que ces innovations bénéficient au plus grand nombre.
La collaboration interdisciplinaire entre neurologues cliniciens, neuroscientifiques, ingénieurs, éthiciens et représentants des patients sera essentielle pour naviguer efficacement dans ce paysage en rapide évolution. Dans cette ère d’innovation neurologique, l’objectif ultime reste inchangé : améliorer la qualité de vie des patients et alléger le fardeau des maladies neurologiques sur les individus, les familles et la société dans son ensemble.
Alors que nous continuons à percer les mystères du cerveau humain, l’avenir de la neurologie n’a jamais semblé aussi prometteur ni aussi riche en possibilités. Les frontières entre ce qui est traitable et ce qui ne l’est pas se redéfinissent constamment, nous rappelant que dans le domaine des sciences neurologiques, ce qui semble impossible aujourd’hui pourrait bien devenir la pratique standard de demain.
Références
1. Cummings J, et al. Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2023. Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions. 2023;9:e12385.
2. van Wamelen DJ, et al. The Changing Face of Parkinson’s Disease Treatment – Personalized Medicine in the Making. Journal of Parkinson’s Disease. 2022;12(1):101-116.
3. Oh J, et al. A New Era of Multiple Sclerosis Treatment: Past, Present, and Future. Journal of Clinical Neurology. 2022;18(4):371-388.
4. Nogueira RG, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. New England Journal of Medicine. 2018;378:11-21.
5. Koren L, et al. Safety and Efficacy of Focused Ultrasound for the Treatment of Movement Disorders: A Systematic Review. Movement Disorders Clinical Practice. 2023;10(4):624-634.
9. Guedes VA, et al. Artificial Intelligence in Neuroimaging: Current Applications and Future Perspectives. Radiology. 2023;309(1):28-41.
10. Cramer SC, et al. Stroke Recovery and Rehabilitation Research: Issues, Opportunities, and the National Institutes of Health StrokeNet. Stroke. 2022;53:1241-1251.